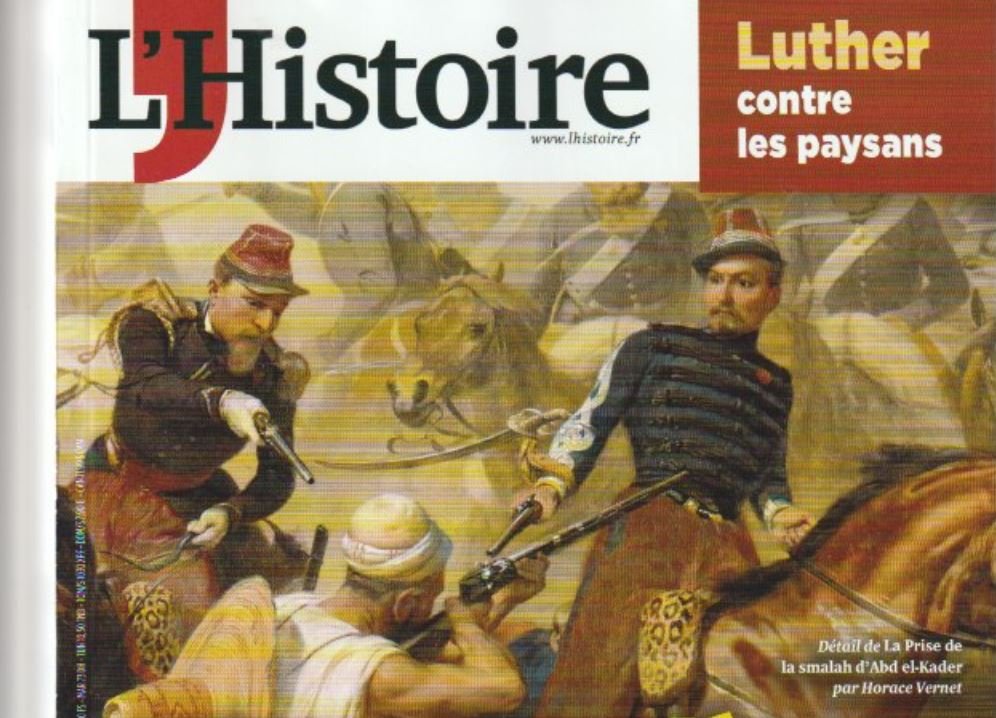Petit à petit, le récit colonial français sort de l’ombre. C’est du moins ce qu’affirme Benjamin Stora dans un entretien accordé à L’Histoire (juin 2025), où il revient sur l’évolution des mentalités face au passé de la conquête de l’Algérie. Mais derrière cet optimisme apparent, plusieurs non-dits et angles morts subsistent.
Tout est parti d’une polémique : le 25 février 2025, sur RTL, Jean-Michel Aphatie a osé comparer le massacre d’Oradour-sur-Glane à ceux perpétrés en Algérie. Une comparaison qui a choqué certains, révélant combien la France peine toujours à assumer son histoire coloniale.
Benjamin Stora, historien bien connu du dossier, minimise : pour lui, l’analogie d’Aphatie visait à “décloisonner” les mémoires. Depuis longtemps, Stora milite pour une meilleure connaissance de cette histoire, en saluant le travail de pionniers comme Charles-André Julien ou Robert Ageron.
Il note que la recherche sur la conquête de l’Algérie s’est densifiée ces vingt dernières années, stimulée par la publication de mémoires de soldats, de harkis, de pieds-noirs — 1,5 million de soldats français ayant combattu en Algérie, rappelle-t-il. La question centrale reste : quelle était l’origine de cette violence ? Vengeance, ressentiment, volonté d’humilier ? Autant de pistes que les historiens explorent.
Mais Stora ne s’arrête pas au travail des chercheurs. Selon lui, le changement des mentalités passe par une médiation sociale plus large : école, médias, réseaux sociaux, débats publics. “Les Français sont mûrs pour affronter cette histoire”, dit-il.
On peut nuancer cet optimisme. Car si des avancées existent (reconnaissance des massacres de Sétif, Guelma, Kherrata de 1945, de l’assassinat de Maurice Audin, des exactions de l’OAS…), la mémoire coloniale continue d’alimenter les crispations franco-algériennes.
La preuve ? Le climat actuel autour de la loi de 2005 sur les “aspects positifs” de la colonisation n’est toujours pas apaisé. Les discours d’extrême droite exploitent régulièrement ces mémoires blessées. Et côté algérien, la demande de reconnaissance des crimes coloniaux reste vive : le président Tebboune a ainsi réitéré en 2024 le souhait d’une commission historique bilatérale.
Le débat, souligne Stora, ne doit pas se limiter à la guerre d’indépendance (1954-1962), mais aussi intégrer la conquête et la colonisation dès 1830. C’est là que les tensions mémorielles sont les plus vives.
Enfin, Stora insiste sur l’importance de replacer la mémoire coloniale dans le cadre d’un récit méditerranéen global. La colonisation française en Algérie n’est pas un fait isolé mais s’inscrit dans un vaste mouvement impérialiste.
Mon avis ? Il y a du vrai dans l’idée que “les esprits sont mûrs” — mais mûrs jusqu’à quel point ?
Si l’on observe les débats publics français, les résistances restent fortes : dès qu’un responsable politique ou un intellectuel évoque les violences coloniales, la machine à polémiques se réactive. La peur d’“abîmer l’image de la France” demeure puissante.
En Algérie, la jeunesse reste profondément marquée par ces blessures non reconnues. Le travail historique est donc essentiel, mais doit s’accompagner d’une reconnaissance politique claire.
Le “dialogue des mémoires” que Stora appelle de ses vœux reste inachevé. Et c’est peut-être moins un problème de maturité des esprits… qu’un problème de volonté politique.
En effet plusieurs angles morts méritent d’être rappelés :
1️⃣ Le poids des lobbies d’anciens d’Algérie : Malgré les avancées historiographiques, le poids politique des réseaux nostalgiques de l’Algérie française reste considérable en France. Associations d’anciens combattants, réseaux de pieds-noirs, groupes parlementaires influents freinent encore toute reconnaissance officielle des crimes coloniaux.
2️⃣ L’instrumentalisation politique de la mémoire : La mémoire coloniale est un levier électoral redoutable. À l’extrême droite bien sûr, mais aussi dans certains segments de la droite républicaine, qui n’hésitent pas à enflammer les débats dès qu’une avancée mémorielle est envisagée. En témoignent les réactions violentes après le rapport Stora de 2021 ou après les discours de Macron à Sétif et Alger.
3️⃣ Le double langage de l’État français : Emmanuel Macron a soufflé le chaud et le froid : discours de reconnaissance d’un côté, refus de “repentance” de l’autre. Cette ambiguïté alimente l’incompréhension des Algériens, pour qui les crimes du colonialisme ne peuvent être soldés par de simples gestes symboliques.
4️⃣ Le silence sur les réparations : Le mot-clé absent de l’entretien est bien celui-là : réparations. Or, pour de nombreux Algériens et pour une partie des chercheurs, sans réflexion sur les conséquences économiques, sociales et humaines de la colonisation, le travail mémoriel restera incomplet.
5️⃣ Une histoire trop franco-française : Enfin, comme le souligne Stora lui-même à demi-mot, l’histoire de la conquête et de la colonisation de l’Algérie n’est pas qu’une affaire franco-algérienne : elle s’inscrit dans une dynamique impériale plus large, méditerranéenne et mondiale. Cet élargissement du regard reste timide dans le débat public.