La Musique Andalouse
J’ai choisi une chanson malouf modernisé
La musique arabo-andalouse est l’héritière de la tradition musicale arabe transmise au ixe siècle de Bagdad (alors capitale des Abbassides) à Cordoue et Grenade grâce notamment à Abou El Hassan Ali Ben Nafiq ou Ziriab (qui en est considéré comme le père), musicien brillant qui en créa à l’époque les bases, en composant des milliers de chants et en instituant le cycle des noubat (nūbāt ou nawbat), composées de formes poétiques tels le muwashshah ou le zadjal (qui furent l’une des sources des Cantigas de Santa Maria du roi Alphonse X de Castille, du flamenco et des troubadours).
Cette musique aura également une influence sur la musique occidentale contemporaine, notamment sur les œuvres de Camille Saint-Saëns à la suite de ses contacts avec des musiciens Algériens, tel Mohamed Sfindja.
La nouba se distingue de la waslah et de la qasida arabes tant par ses modes que par ses formes. À sa suite, Abu Bakr Ibn Yahya Al Sayih, dit Ibn Bâjja ou (Avenpace), poète et musicien lui aussi, a mis au point l’accord du oud, a perfectionné la nouba et a laissé un grand nombre de compositions.
La musique arabo-andalouse développée en Espagne s’est propagée grâce aux échanges importants entre les centres culturels d’Andalousie formant trois grandes écoles dont se réclameront des centres culturels du Maghreb :
- Grenade (à Tlemcen, Oran Nedroma et Sidi Bel-Abbès en Algérie – Rabat, Oujda,, Tétouan, Tanger et Chefchaouen au Maroc)
- Cordoue (à Meknès au Maroc – Alger, Béjaïa, Mostaganem, Cherchell, Miliana, Médéa, Blida et Koléa en Algérie)
- Séville (à Fès au Maroc – Constantine, Skikda, Annaba et Souk Ahras en Algérie – Tripoli en Libye – Kairouan et Testour en Tunisie)
- Valence (à Tunis en Tunisie)
En Algérie, il y a 12 nouba complètes : al-dhîl, mjenba, al-hussayn, raml Al-mâya, ramal, ghrîb, zîdân, rasd, mazmûm, rasd Al-Dhîl, mâya ; et 4 inachevées : ghribet Hassine – araq – djarka – mûal.
Elles sont composées chacune de cinq mouvements de base : msaddar – btâyhî – rarj – insirâf – khlâs, mais des préludes et des interludes en portent le nombre jusqu’à sept ou neuf :
- Mestekhber çanâa (Alger) ou Mishalia (Tlemcen): prélude instrumental de rythme libre, exécuté à l’unisson ;
- Tûshiya : pièce instrumentale servant d’ouverture ;
- Msaddar : pièce vocale et instrumentale la plus importante, de l’arabe sadr : « poitrine » pour signifier l’importance de cette pièce vocale ;
- Btâyhi : deuxième pièce vocale et instrumentale, construite sur le même rythme que le Mçedder, de l’arabe bataha : étendre, étaler qui donnera batha désignant un vaste lit de torrent. ;
- Darj : troisième mouvement chanté et instrumental construit sur un rythme binaire, plus accéléré que les deux précédentes pièces, du verbe daraja : « marcher, s’avancer, escalader » ;
- Tûshiya el Insirafate : pièce instrumentale annonçant une partie accélérée et vive, construite sur un rythme ternaire, seules deux tushiyyat al-insirâfât subsistent : l’une dans la mode ghrib, l’autre dans le mode hsin ;
- Insirâf : quatrième mouvement vocal et instrumental à rythme ternaire, de l’arabe insirâf : « départ, décapement, accélération » ;
- Khlâs : ultime pièce chantée exécutée sur un rythme alerte et dansant ;
- Tûshiya el Kamal : pièce instrumentale construite sur un rythme binaire ou quaternaire, de l’arabe kamâl : « perfection ».
Le sous-système constitué de nqlabat connaît le rythme n’sraf emprunté à la nuba, plus d’autres rythmes spécifiques (bashraf, sûfiân, berwâli, etc.)21.
Les formes poétiques qui existent encore sont : Muwashshah – Zadjal – Msaddar- Shugl (poème chanté populaire)- Barwal (pratiqué à Constantine) – Melhoun- El Wahrani (variante oranaise du Melhoun).
Il existait à Alger et à Tlemcen quinze nouba, quelques unes d’entre elles, celles en mode jeharkah, iraq et maoual ont été oubliées.
La musique savante arabo-andalouse est appelée Al moussiqa al andaloussia (« musique andalouse ») lorsqu’il n’est pas fait référence à l’une des trois importantes écoles présentes en Algérie qui pratiquent cette musique avec des nuances distinctes :
- le gharnati, de l’école de Tlemcen, se rattachant à Grenade, il s’implantera plus tard au début du xxe siècle, au Maroc, à partir de Tlemcen, et d’Alger,
- le sanâa d’Alger se rattachant à Cordoue
- le malouf de Constantine se réclamant de Séville
A/ Le Malouf
Le “malouf” est la forme qu’emprunte la tradition musicale arabo-andalouse à Constantine et en Tunisie. Ce mot signifie en arabe, “fidèle à la tradition”. Fidélité au patrimoine musical qui s’est enrichi dans l’Andalousie, du VIIIe au XVe siècles, dans les cours royales, les cénacles intellectuels et les jardins des délices, à Grenade, Cordoue, Séville, mêlant musulmans et juifs, dans la célébration de l’amour courtois et de l’élan vers Dieu. Avec l’expulsion d’Espagne, en 1492, des musulmans et des juifs, s’est fermée une page, dont les échos cependant perdurent dans l’Ibérie d’aujourd’hui.
S’est ouverte une nouvelle page, en Afrique du Nord et dans toute l’aire arabo-musulmane, de l’Océan aux confins de la Perse. Musique vivante, même si ses modes savants et , surtout, sa transmission orale l’ont soumise à bien des vicissitudes. Ainsi, des vingt-quatre “noubat” originelles, autant de suites correspondant aux heures de la journée, l’Algérie n’a-t-elle pu conserver que douze.
Liste des plus grands et anciens maîtres de cette grande musique Malouf :
H’mida ben Lamssabah
Nassim Boukebous – moitié du XIXème siècle
Mohamed Melouk – fin du XIXème siècle
Bestandji Ahmed – 1875/1946
Bestandji Abdelkerim – 1886/1940
Benlamri Larbi – 1890/1966
Baba Alaoua Bentabal – 1890/12-08-1976
Kara Beghli Abdelrahman (dit baba oubaid adou) – 1886/1956
Omar Chnouffi (dit chakleb) – 1857/1964
Tahar Benlamrabat – 1898/1947
Tahar ben Kertoussa – 1881/1946
Ali Khodja Ali (dit si h’souna) – 1856/1971
Berachi Mamar – 1904/1981
Toumi Siaf Abdelkader – 1906/2005
Voici, tiré du livre de Maya Saïdani ”LA MUSIQUE DU CONSTANTINOIS’ ‘, Editions Casbah, un tableau contenant la majorité des grands interprètes et maîtres du Malouf, nés entre 1810 et 1957.
Nom et prénom |
Année de naissance |
Année de mort |
Âge à la mort |
Principaux instruments joués |
| Benm’sabah H’mida |
1810 |
1905 |
95 |
Darbouka |
| Benkurat |
1824 |
1907 |
83 |
Alto |
| Maluk |
1830 |
1914 |
84 |
Darbouka |
| Nabet Y. |
1830 |
1893 |
63 |
Ud arbi |
| Bestandji Ahmed |
1875 |
1946 |
71 |
Ud arbi |
| Belkartoussa Tahar |
1881 |
1946 |
65 |
Flûte |
| Fergani Hamou |
1884 |
1971 |
87 |
Ud arbi |
| Karabaghli Baba Abid |
1886 |
1956 |
70 |
Flûte |
| Bestandji Abdelkrim |
1886 |
1940 |
54 |
Ud arbi |
| Bouhouala Omar |
1889 |
1978 |
89 |
Darbouka |
| Bentobal Allaoua |
1892 |
1969 |
77 |
Darbouka |
| Belamri |
1893 |
1966 |
73 |
Darbuka |
| Ali Khdja H’Souna |
1896 |
1971 |
75 |
Darbuka |
| Chennoufi Omar, dit Omar Chaqlab |
1902 |
1942 |
40 |
Darbuka |
| Bemdjelloul Mohamed |
1902 |
1980 |
78 |
|
| Ammouchi Brahim |
1903 |
1990 |
87 |
Mandoline |
| Berrachi Maamar |
1904 |
1989 |
85 |
Darbuka |
| Toumi Abdelkader |
1906 |
2005 |
99 |
Alto |
| Raymond Leyris |
1912 |
1961 |
49 |
Ud arbi |
| Fergani Zwawi |
1913 |
1995 |
82 |
Ud arbi |
| Benlabdjaoui Abdelhamid |
1914 |
1978 |
64 |
Tar |
| Ghenassia Sylvain |
1914 |
2004 |
90 |
Alto |
| Darsouni Mohamed dit Kaddour |
1927 |
Flûte | ||
| Bentobal Abdelmoumen |
1928 |
2004 |
76 |
Ud arbi |
| Fergani Mohamed-Tahar |
1928 |
2016 |
Tous |
|
| Fergani Salim |
1953 |
Ud arbi | ||
| Sammar Mustapha |
1953 |
Ud arbi | ||
| Zaarour Mohamed-Chérif |
1954 |
Flûte et guitare | ||
| Bouda Kamel |
1957 |
Alto |
Remarquez que Le maestro Mohamed Tahar Fergani jouait de tous les instruments, ce qui est vraiment rare.

A suivre….






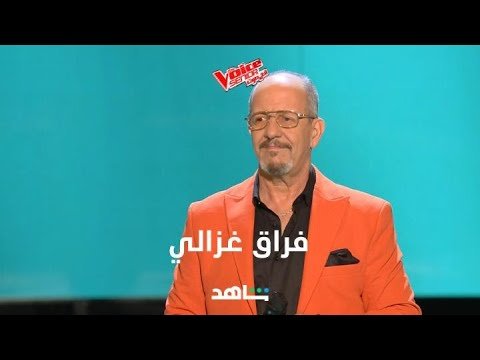
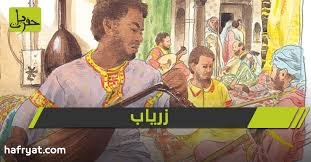


2 comments
Mon frère Muhammad Redha.
Merci beaucoup, vous avez abordé un sujet de grand désir et de beauté.
En parcourant votre sujet aujourd’hui, j’avais l’impression d’errer dans un jardin que je connais. Cet héritage est un pilier solide de notre identité algérienne. Bien que beaucoup ne connaissent pas précisément tous ses bâtiments et composants dans l’ordre, mais la plupart des Algériens fait vivre ce patrimoine dans ses veines et à travers ses trois écoles (Gharnati, Sanaa et Malouf) qui couvraient le pays et s’étendaient hors de celui-ci de l’est la Tunisie et la Libye et à l’ouest jusqu’au Maroc.
Je ne cache pas que je fais partie de ceux qui sont passionnés par ce patrimoine, et parce que je suis de la ville d’Alger, j’ai tendance à l’école de Sanaa, et cela ne veut pas dire que je néglige les autres écoles, au contraire je les apprecie aussi. Parmi les caractéristiques artistiques de ma ville, comme vous le savez, il y a la musique populaire Chaabi issu de cet héritage, cet art que j’adore avec pureté et que j’en ressens avec chaleur. cet art a acquis une certaine partie de ma formation de personnalité, j’en ai donc appris un peut de litterature et de l’histoire et surtout la modestie, et j’en suis devenu un véritable amoureux.
Et avant de finir, et pour vos efforts dans la définition de cet héritage et la description de mon cas (amour) en rencontrant cet héritage, je vous en offre quelque chose comme :
إنصراف رمل ماية ” ياعاشقين صدِّقوا “.
ياعاشقين صدِّقوا
لأننى عاشق و مُفني
نعشق بروحي وعيني
منها القلوب يخفقوا
من مُشرفٍ و مستجنّي
قطوفها كلّ مُفني
إذا لقيت من نعشقُه
كالزعفران صار لوني
وحالتي توري عنّي
نبكي ونشتكي من هذه القضية
أللي حاز عقلي يا شبه الثُريّة.
Merci Toufan mon ami pour cette vibrante interaction.
En guise de remerciement pour les jolis vers que vous m’aviez offerts, laissez-moi vous dire une chose:
Lesdits vers ne m’auraient pas plu (plutôt sentis pour être précis) s’il n’y avait pas eu votre récits plus haut décrivant avec une grande chaleur ce qu’ un amoureux de cet art pourrait sentir ….wallah…c’est de ces sensations émanant de vos mots (même choisis avec délicatesse et non spontanés) que vos vers (ابيات) ont pu avoir de l’effet sur moi.
Pour ma part j’écoute tout hahaha sauf l’occidental, je ne sais pas pourquoi, peut être le quart de note que les autres musique contiennent qui est à la source de mon éloignement (sauf le Country que j’adore) …
Heureux que cela vous a plu et merci pour votre intérêt….
Merci