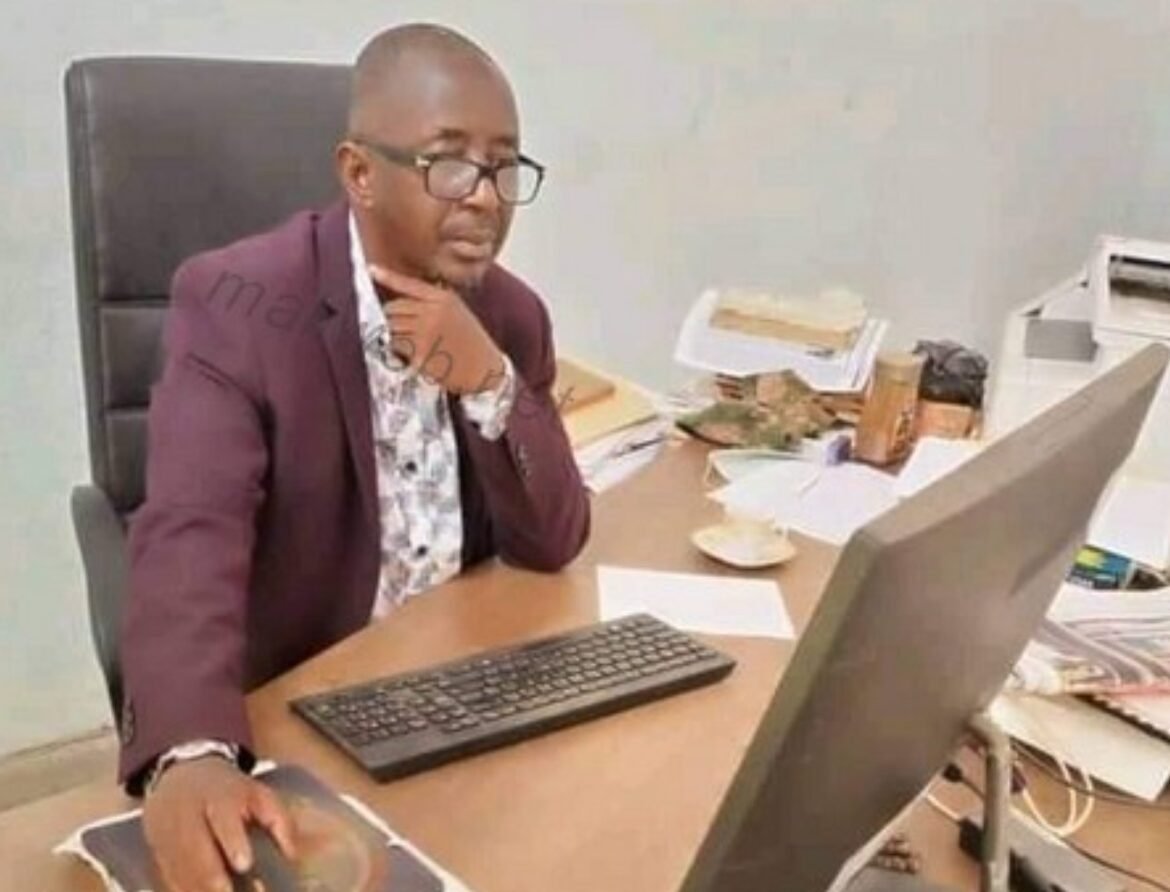Souveraineté, désespérément…
Par Amadou N’Fa Diallo
Faut-il, pour que ce titre sonne net, remplacer les pointillés par un point d’interrogation ou par un point d’exclamation ? A trois petits jours du lundi prochain, 22 septembre 2025, question à mille sous aux Maliens et aux Africains soucieux de l’Afrique, à l’occasion du 65ème anniversaire de l’indépendance de la plupart de nos pays, en 1965.
Un constat amer : le Mali n’est pas plus à la traîne comme nombreux d’autres Républiques sur le continent, qui n’ont de perspectives de développer que cueillir des dettes qui n’ont jamais assuré le développement à leurs peuples, en 65 ans, bien au contraire. Alors, un autre constat amer : si au début des indépendances durant l’année 1960, l’Afrique a vite eu conscience de la nécessité de son unité (qui se matérialisa théoriquement en 1963 avec la création de l’ONU en 1963 à Addis-Abeba), il est difficilement soutenable qu’elle a pris la pleine confiance en elle-même pour une « remontée à jamais vue » qui lui est toujours nécessaire pour devenir pleinement souveraine. Car, pour être vraie et réelle pour un pays, un peuple et un État, la souveraineté a besoin d’afficher les figures nobles incontournables et admirables : la souveraineté politique, la souveraineté alimentaire, la souveraineté monétaire, la souveraineté financière, la souveraineté sanitaire et la souveraineté économique, en plus d’une Armée et d’une diplomatie progressiste.
La première République du Mali s’est hardiment engagée dans cette quête, avec enthousiasme et patriotisme intransigeant. Les contingences de l’heure, les hostilités multiformes et incessantes d’une certaine FrançAfrique, et peut-être les luttes de jactance entre acteurs nationaux, ont contrarié la belle chevauchée. A la décharge des responsables qui ont eu le Mali en charge entre 1960 et 1968, on peut avancer l’excuse du déficit des ressources humaines, ces compétences indispensables aux grandes ambitions Le Mali manquait alors de hauts cadres à l’indépendance, le pays ne comptait que 15 universitaires.
L’équipe dirigeante était, en grande majorité, composée d’autodidactes. Par exemple, le premier Directeur général d’Air Mali, fleuron admiré sur le continent, était un sténo dactylo et le premier Gouverneur de la Banque de la République du Mali (Banque Centrale) était un syndicaliste. Il s’y ajoute, prééminence de la politique l’exigeait, que le Parti US-RDA était au-dessus du Gouvernement et les nominations aux postes se faisaient conséquemment selon le degré de militantisme et non de compétence. Mais ces hommes et ces femmes, ont montré la voie de l’honneur et de la dignité. Ils ont conçu d’importantes unités industrielles, créé des entreprises avant-gardistes : la Société de construction des Radios du Mali (SOCO-RAM), la Tannerie du Mali (TAMALI) qui devrait parvenir à produire les chaussures et les ceinturons des militaires, les charcuteries, les confiseries. Ils avaient même, avec l’Allemagne, un projet pour fabriquer du chewing-gum à partir de la gomme de karité. Ils avaient même analysé le sable du Lac Faguibine et auraient réussi à produire avec.
Aujourd’hui, nous sommes au temps des bardés de diplômes, il n’existe pas de disciplines enseignées dans les plus grandes universités dont les nôtres ne sont des spécialistes et experts.
Mais travaillons dans l’intérêt de nos pays ? Ce n’est pas facile à répondre.
La Chine n’est indépendante que depuis 1949 et elle se classe comme la deuxième puissance économique mondiale ; elle aurait été, en 1960, au même niveau de développement que la Côte d’Ivoire et le Ghana. L’Inde n’est indépendante que depuis 1947 et se classe 4ème puissance économique mondiale.
Il nous faut travailler, c’est la clé du succès et de la prospérité.
Malheureusement, tout l’avenir, pour nous dépend, des dettes et des oboles données par des pays arabes qui n’ont pourtant pas plus de ressources que nous. Nous sommes loin de comprendre et d’admettre que ce sont les pays en difficulté qui sollicitent l’assistance du FMI et de la Banque Mondiale.
Mais que fait-on des dettes ? Payer des salaires ou augmenter les investissements productifs qui permettent de générer des ressources supplémentaires ?
Alpha Oumar Konaré, le tout premier président de la République du Mali, élu au suffrage universel après deux mandats, explique avec son éloquence particulière comment les institutions de Bretton Woods nous tiennent comme le pendu par la corde : « Nous avons subi les programmes d’ajustement structurel du FMI et de la BM, qui ont été des catastrophes, qui nous ont conduits, sous couvert de privatisation, à des liquidations, à l’affaiblissement de l’action, à l’affaiblissement de la Fonction publique, qui nous ont amenés à brader certains avoirs nationaux. Mais le problème, c’est que nous étions dans un pays fragilisé par les conflits. Nous étions dans un pays où, si nous voulions affronter ces organisations internationales, si nous voulions affronter des multinationales pour mieux négocier les prix de l’or et du coton, il nous fallait un consensus national. Nous avons vu, quand il y a eu des velléités, que cela pouvait conduire, à la limite, à la chute du régime »
Amadou N’Fa Diallo (in “Le National”)