Des archives inédites et des études récentes pour mieux comprendre l’Algérie mathématique du XIXe siècle.
Piste verte Le 14 mai 2016 Voir les commentaires

Le 23 avril 1863, l’archéologue Louis Adrien Berbrugger (1801-1869), qui avait été secrétaire particulier du Maréchal Clauzel, et qui avait participé à plusieurs expéditions de l’armée coloniale, pouvait affirmer dans sa séance inaugurale de l’Assemblée de la Société historique algérienne, qu’il avait fondée et présidée, que l’Algérie était un pays « sans savants, sans traditions savantes et même sans livres ». Cet article – construit sur des archives largement inédites et des études récentes – conteste cette triple négation. Il y a dans l’Algérie du XIXe siècle des savants, une tradition savante et des livres de sciences. Il y a aussi, venus pour la plupart de Paris, des ingénieurs, des professeurs et des ingénieurs qui y exercèrent leur métier et, en marge, des mathématiques.
De nombreux documents manuscrits non publiés du XIXe siècle, notamment après la conquête coloniale de l’Algérie, ont été localisés ces dernières années et permettent de se faire une idée assez précise des activités scientifiques au Maghreb à cette époque.
- L’Âge d’or des Sciences en Pays d’Islam. Les manuscrits Scientifiques du Maghreb.
Ces documents contiennent des textes de mathématiques au sens classique où nous l’entendons aujourd’hui (arithmétique, analyse, géométrie) mais aussi des travaux sur la terre, le ciel, la mer, l’espace et le temps. Au XIXe siècle, ces terrains d’études sont ceux du mathématicien ou comme on dit alors du « savant » ou « du « géomètre ». Nous proposons ici des études de cas permettant de saisir, en pratique, les activités savantes professionnelles ou extra-professionnelles de quelques acteurs ayant exercé au Maghreb. Toutes les histoires d’hommes qui suivent s’inscrivent dans un contexte politique et sociétal particulier : au Maghreb avant la prise d’Alger (1830) puis au temps de la colonisation tout au long du dix-neuvième siècle [1].
Ce sont ainsi des dizaines de savants, militaires, fonctionnaires de l’administration ou enseignants – souvent polytechniciens – qui, tout en exerçant les fonctions qu’ils devaient assumer aux quatre coins du Maghreb, poursuivirent tout au long du dix-neuvième siècle différents types de travaux relevant des mathématiques. Au XIXe siècle – comme aujourd’hui – les mathématiques ne sont pas qu’aux seules mains des professionnels des mathématiques (enseignants, chercheurs, académiciens, etc.) ; elles se déploient aussi dans d’autres sphères comme celle des ingénieurs formés dans les grandes écoles (École polytechnique entre autres). Férus de sciences et de mathématiques, ces derniers ont souvent continué à en faire ou à les diffuser en marge de leur profession. Ils sont souvent désignés par les acteurs de l’époque sous le qualificatif de « savants géomètres ».
- Le Maghreb et l’Algérie
Beaucoup de ces personnages relevaient des mathématiques que nous pourrions qualifier d’appliquées de par la formation de ces savants (souvent polytechniciens répétons-le) mais aussi, et sans doute dans une moindre mesure, des mathématiques « pures ». Nous n’insisterons guère sur ces dernières et nous nous contenterons seulement de citer en préambule le cas relativement connu de Gaston Tarry (1843-1913). Tarry a étudié en mathématiques spéciales au lycée Saint-Louis avant de faire toute sa carrière – jusqu’à sa retraite en 1902 – au Service des contributions diverses à Alger. En relation avec d’autres savants notamment grâce au réseau de sociabilité scientifique qu’ont été les congrès de l’Association Française pour l’Avancement des Sciences, Tarry a exposé différentes solutions de problèmes de combinatoire. Sa contribution la plus connue est celle qui concerne la conjecture d’Euler dite des trente-six officiers, à savoir qu’il n’est pas possible de placer trente-six officiers de 6 grades différents et appartenant à 6 régiments différents dans un tableau de 6 x 6 de façon que sur chaque ligne et chaque colonne, on trouve 6 officiers de grades différents et de régiments différents. [2]
ENTRE TERRE ET MER : « LA COMMISSION SCIENTIFIQUE » OU EXPLORER L’ALGÉRIE
Avant la conquête de l’Algérie, pendant ce que les historiens nomment la « régence d’Alger », retenons la présence (par hasard) de François Arago (1786-1853) [3].
Il devait aller mesurer la méridienne et, suite à différents ennuis en mer, débarque dans la ville médiévale de Bougie (Béjaia) le 05 décembre 1808. Il y séjourne quelques semaines avant de traverser la Kabylie ; une traversée qu’il décrit avec force détails dans Histoire de ma jeunesse (1854). Plus tard, il fait partie de la Commission scientifique pour l’Algérie, une structure destinée à étudier scientifiquement les différentes ressources et potentialités du territoire algérien [4].
- Gravure de Bejaia au temps d’Arago, réalisée par Louis de Habsbourg, Archiduc d’Autriche
La commission scientifique n’est pas seulement tournée vers la terre, avec de nombreuses études minérales et hydrologiques, mais aussi vers la mer également comme l’atteste la présence parmi ses membres de Georges Aimé (1810-1846). Né le 27 janvier 1810 à Metz, il vient, en 1828, à Paris au lycée Louis-Le-Grand pour préparer le concours d’entrée à l’École polytechnique. Il échoue et entre à l’École normale avec la promotion 1831 (section des sciences), mais dès cette date il publie divers travaux de physique par le biais de l’Académie des sciences. Il réussit sa licence de sciences mathématiques mais échoue à l’agrégation des sciences. [5]
Remarqué par Arago, il entre à l’Observatoire de Paris comme attaché et publie ses travaux dans les Annales de chimie et de physique … d’Arago. Il est ensuite nommé membre de la Commission scientifique pour l’Algérie (sans doute vers 1835) et s’établit à Alger où il est professeur de physique au lycée de la ville, ancêtre du lycée Bugeaud puis Émir Abdelkader après l’indépendance. [6]
En sus de ses enseignements, il y fait d’importantes découvertes océanographiques en mesurant expérimentalement différentes composantes physiques des vagues de la baie d’Alger. Il meurt accidentellement en 1846 et est, pour certains historiens, l’un des pères de l’océanographie. [7]
- Baie d’Alger en 1858
ENTRE-TEMPS OU HISTOIRE ET MÉTÉOROLOGIE : Eugène Dewulf, Albert de Ribaucour et Henri Brocard
La conquête française de l’Algérie suscite d’emblée de nombreuses vocations d’arabisants et d’archéologues s’employant à noter des inscriptions et décrire des ruines romaines. Deux d’entre eux ont attiré particulièrement notre attention : il s’agit d’Eugène, Édouard Dewulf (1831-1896) et d’Albert Ribaucour (1845-1893). [8]
Entré à l’École polytechnique en 1851, Dewulf séjourne en Algérie à plusieurs reprises en 1856, 1861 et 1871 en tant qu’officier de l’armée française au service de la colonisation. Militaire et ingénieur, il est aussi féru de mathématiques. Lycéen, il écrit dans les Nouvelles annales de mathématiques en participant à la rubrique questions/réponses, en écrivant des articles et en traduisant en 1862 – à la demande du co-fondateur Olry Terquem (1782-1862) – un texte important de Ernst Kummer (1810-1893). [9] et [10]
- Le premier article de l’officier Dewulf dans les Nouvelles annales de mathématiques
En Algérie, Dewulf apprend l’arabe et s’intéresse activement aux manuscrits médiévaux de Bougie (Béjaia). Nous possédons de nombreuses archives (correspondances) éclairant de manière très pragmatique le séjour algérien de Dewulf. Ainsi, sa correspondance avec le savant italien Luigi Cremona est particulièrement riche de multiples informations. [11]
- Lettre de Dewulf à Cremona, 14 août 1863
Il a notamment participé à la fantastique aventure intellectuelle du XIXe siècle, dont l’objectif était de retrouver le fameux manuscrit an-Nubda al-Muhtaja fi Akhbar Sanhadja bi Ifrikiya wa Bijaya. Son auteur est l’historien Ibn Hammad (1150–1230), descendant direct des princes hammadites. Cette source, encore aujourd’hui considérée comme perdue, a été utilisée par plusieurs historiens postérieurs (Ibn Idhari, Ibn Khaldun…). Après avoir effectué des recherches en Allemagne, en Italie et en France, Dewulf affirmait dans une correspondance datée de 1865 qu’il était sur le point de le retrouver « dans une très ancienne école kabyle, dans la Zawiyya de Chellata ».
- La Khizana (Bibliothèque) de la Zawiyya de Chellata (XVIIIe siècle)
- Représentation de la comète C/1769 P1 par l’astronome Ash Shallâtî au 18e siècle
Dewulf précise : « le marabout auquel appartient cette Zawiyya m’a affirmé qu’il a en sa possession le manuscrit que je cherche et qu’il me l’enverra ». Précisons qu’à cette époque, Eugène Dewulf avait « abandonné » ses travaux de géométrie pour se consacrer à la recherche des manuscrits de mathématiques. [12]
Dans une correspondance avec le géomètre italien Luigi Cremona, rédacteur d’une revue de mathématique, il demande à présenter les manuscrits retrouvés. La liste (des manuscrits) jointe à la lettre n’a pas été retrouvée dans les archives. Il est probable qu’elle ait été envoyée au Prince Boncompagni, médiéviste et éditeur de nombreux textes mathématiques (et notamment le Liber Abbaci et la Practica Geometriae de Fibonacci). Ce dernier s’intéresse particulièrement au mouvement de traduction de l’arabe au latin avec la figure de Gérard de Crémone [13]. Alors qu’il est encore en poste en Algérie, en 1872, Eugène Dewulf va faire partie des membres fondateurs de la Société mathématique de France. [14]
Le parcours d’Albert Ribaucour est également particulièrement documenté. Nommé, le premier juin 1886, à l’emploi de chargé au contrôle des travaux du chemin de fer reliant Bougie (Béjaia) à Beni-Mansour, il est déjà un mathématicien spécialiste de géométrie différentielle très connu dans les milieux scientifiques européens. Il avait, entre autres, obtenu en 1877 le prix Dalmont de l’Académie des Sciences de Paris et un prix de L’Académie Royale de Belgique en 1880. L’utilisation de sa correspondance [15] permet de suivre avec précision ses contributions mathématiques pendant son séjour algérien, ainsi que de situer ses travaux d’ingénieur à Philippeville (Skikda) et à Bougie (Béjaia) : construction de l’hôtel des postes, de l’ancienne sous-préfecture, d’un pont, d’un quai du port, etc. [16]
- Schéma de Ribaucour sur l’exécution de la grande jetée du Nord du Port de Phillippeville
La découverte récente du dossier de réutilisation de l’aqueduc de Saldae (Toudja) montre que c’est Albert Ribaucour qui a piloté ce projet en 1891. Un document signé de sa main permet de comprendre son influence sur les pouvoirs en place et d’expliquer les péripéties qui ont entouré ce monument romain préservé dans différents lieux de la région de Toudja et Bougie (Béjaia).
- Reconstitution de l’Aqueduc de Saldae (Dessin K. Bourihane)
- Ribaucour signe en 1896 le projet de réutilisation de l’aqueduc de Saldae (Toudja)
Terminons en insistant plus longuement sur le rôle joué par Henri Brocard (1845-1922) car il a passé plusieurs années fructueuses sur le plan scientifique, en Algérie, en participant très activement à la mise aux normes du réseau météorologique algérien. Il entre à l’École polytechnique en 1865 puis rejoint le corps des ingénieurs de l’armée française. De sa longue carrière militaire, deux périodes se distinguent : ses affectations au service météorologique d’Alger et celles en Écoles régimentaires. En parallèle à sa carrière militaire, Brocard fournit une importante production mathématique, en particulier sur la nouvelle géométrie du triangle. [17]
L’ouvrage le plus remarquable de Brocard est un travail en deux parties, Notes de bibliographie des courbes géométriques et Courbes Géométriques remarquables, qu’il a écrit avec Timoléon Lemoyne et qui a paru en 1897 et 1899. [18].
En cumulé, Brocard passe plus de huit ans en poste en Algérie. Ses affectations les plus longues et les plus signifiantes sont celles au service météorologique d’Alger comme adjoint au général Farre (janvier 1874-novembre 1876 puis novembre 1879–avril 1882). Brocard travaille au bureau qui centralise « tous les documents recueillis dans les stations météorologiques africaines ». [19]
Il est également titulaire des commissions météorologiques de Constantine, Alger et Oran. Les détails de la mission de Brocard nous sont connus grâce à sa Notice sur les titres et travaux scientifiques. [20]
Durant sa première affectation, il intensifie et modernise le réseau existant après avoir suivi les instructions du géologue Charles Sainte-Claire Deville (1814-1876) alors que sa deuxième venue est consacrée à l’inspection et l’amélioration de l’ensemble des installations (une quarantaine). Sainte-Claire Deville fait une référence forte élogieuse au travail de Brocard dans une note présentée à l’Académie des sciences en 1874. Lors de la mise en place du réseau, Charles-Ange Laisant (1841-1920), polytechnicien d’origine nantaise, militaire, homme politique, mathématicien et homme de presse sert sous les ordres de Brocard. [21]
Cette rencontre amorce une longue collaboration entre les deux hommes, notamment autour de la revue l’Intermédiaire des mathématiciens, cofondée par Laisant en 1894. Brocard s’implique dans la vie éditoriale du journal de sa création à 1904 comme l’indique l’extrait du tome XI ci-dessous dans lequel les rédacteurs le remercient de sa contribution.
- C-A Laisant, E. Lemoine, E. Maillet, A. Grévy, Intermédiaire des Mathématiciens, XI (1904), p. 316.
Lors de ses séjours en Algérie, Brocard ne se cantonne pas à son statut de météorologue mais s’investit dans des activités de vulgarisation et de diffusion scientifiques. En 1874, il rédige un essai de vulgarisation scientifique sous la forme d’une série d’articles publiés de façon hebdomadaire de décembre 1874 à octobre 1875 et visant à donner des « notions d’astronomie populaire ». Ce travail lui a été commandé par le Commandant Aublin, chef du bureau des affaires indigènes du Gouvernement Général de l’Algérie. Brocard participe aussi à l’exposition générale de la Société d’Agriculture qui se tient à Alger en 1876 et pour laquelle il est nommé membre du jury des récompenses aux exposants de la section des machines agricoles.
UN NOUVEL ESPACE À CARTOGRAPHIER AVEC LES INGÉNIEURS GÉODÉSIENS : Charles Louis Dupin et André Louis Cholesky
- L’Algérie mise en carte : Carte du Maghreb Central à l’époque des « siècles obscurs du Maghreb »
La France est héritière d’une longue tradition cartographique. La carte – première traduction du monde – est au service du pouvoir. Sous l’Ancien régime, la géographie est intégrée dans l’éducation. Elle sert à connaître le royaume afin de mieux le réformer et d’organiser son développement économique. La cartographie ne cesse de se perfectionner scientifiquement au fur et à mesure du Siècle des Lumières et au XIXe siècle. L’Algérie est un nouveau territoire à conquérir et à cartographier aussi y envoie-t-on de nombreux « ingénieurs géodésiens » dont beaucoup furent formés à l’École polytechnique. [22]
L’historiographie récente montre, en croisant l’histoire des savoirs et de la colonisation, toute l’importance des cartes et des évolutions de la cartographie pour les gouvernants, les sociétés et les peuples. [23]
Nous nous contenterons ici de citer deux parcours d’ingénieurs polytechniciens ayant joué un rôle important dans la « mise en cartes » de l’Algérie. Le premier est celui du colonel Charles-Louis Du Pin (1814-1868) et s’inscrit dans les premiers temps de la présence française en Algérie. [24]
Du Pin s’est livré à un important travail de terrain et a dirigé la finalisation de cartes topographiques qui font encore référence par leurs précisions avec leurs points d’eau, la localisation et le nom de chaque tribu, les ressources en bois, en fourrage, etc.
Le second parcours que nous étudierons est celui d’André-Louis Cholesky (1875-1918). Grâce à un important fonds d’archives récemment acquis par les Archives de l’École polytechnique, nous connaissons précisément le rôle scientifique de Cholesky au Maghreb. Après plusieurs séjours en Tunisie (1902-1903), il se rend en Algérie (1912-1913). [25]
Il s’y est livré à d’importants travaux de triangulation ayant pour but la construction d’une ligne de chemin de fer entre Orléansville (Chlef), Vialar (Tissemsilt) et Trumelet (Dahmouni) afin de relier le plateau agricole du Sersou à la vallée du Cheliff. Des difficultés considérables furent rencontrées à cause du terrain accidenté et de la rigueur du climat du massif de l’Ouarsenis. Un tronçon de la route entre Biskra et Touggourt fut également nivelé. C’est face à ces difficultés de terrain que Cholesky prend la peine de rédiger une note qu’il intitule « Sur la résolution numérique des systèmes d’équations linéaires ». Cette méthode est aujourd’hui l’un des piliers de l’analyse dite numérique et est désignée par « méthode de Cholesky ». [26]
OBSERVER LE CIEL ET CROISER LES REGARDS, EN 1860 : avec l’École polytechnique, l’Académie des sciences, l’Observatoire d’Alger et de Batna et des … indigènes.
- L’éclipse de 1860
L’importance accordée à l’éclipse totale du soleil de juillet 1860 par les scientifiques français peut être appréciée à travers les deux expéditions organisées sous l’égide de l’Académie des sciences et de l’École polytechnique. La notice de l’astronome Bulak de l’observatoire d’Alger, publiée par la Revue africaine de 1860 mais rédigée avant l’éclipse, montre que le phénomène avait été prédit avec précision par les savants occidentaux (faisceau, début et fin de l’éclipse dans plusieurs régions, obscurité totale…). Sur les expéditions françaises, nous disposons de nombreuses sources primaires et secondaires notamment sur les observations faites à l’observatoire de Batna.
- L’observatoire de Batna
Qu’en est-il du côté autochtone ? A contrario de ce qu’affirmait Berbrugger et que nous avons rappelé en préambule de notre article, l’Algérie disposait et de savants, et d’une tradition savante et de bibliothèques à l’instar de La Khizana (bibliothèque) de Cheikh Lmuhub (1822-vers 1900). [27]
- La Khizana de Cheikh Lmuhub (milieu du XIXe siècle)
Les nombreux traités de mathématiques sont là pour attester qu’il existait une tradition savante autochtone. Nous disposons de très peu de documents « algériens » sur cette éclipse de 1860. Néanmoins, une pièce que nous avons retrouvée dans Afniq n’Ccix Lmuhub (Bibliothèque savante de manuscrits), la décrit et montre que, côté autochtone, le phénomène n’a été qu’observé et répertorié. Sur le manuscrit KA N° 02 figure la note suivante : « Le 29 Dhy Hidja 1276 de l’hégire à 7 heures, étaient présents, le Qadi Muhammad La`arbi Ben Mesbah et le Faqih Muhammad Seghir Benkhelifa al-Fetzatti pour assister à un héritage entre Cheikh Lmuhub et son frère La`arbi. Il s’est produit une éclipse totale du soleil ». [28]
- Répertoire des manuscrits de la bibliothèque de Cheikh Lmuhub rédigé par son fils à la fin du XIXe siècle
- L’éclipse de 1860 vue par Cheikh Lmuhub et Qadi Ben Mesbah
BILAN ET PERSPECTIVES
À travers ces quelques exemples de parcours, grâce à une historiographie récente, puisqu’elle repose essentiellement sur des sources bibliographiques publiées ces dernières années, et également sur des sources archivistiques pour beaucoup d’acquisition ou d’exploitation récente, nous avons pu montrer quelques-uns des champs d’investigation scientifique explorés par des ingénieurs polytechniciens (ou fonctionnaire comme Gaston Tarry ou professeur comme Georges Aimé) français ayant effectué des séjours en Algérie tout au long du XIXe siècle. Ces hommes ont eu des parcours très différents en Algérie ou, plus généralement, dans le Maghreb. Certains y ont effectué toute leur carrière professionnelle, d’autres n’y sont restés que quelques mois ou quelques années. Tous ont contribué, au-delà de leurs contraintes professionnelles et dans des proportions très différentes au développement des mathématiques pures et appliquées ou à d’autres champs des connaissances. Pour certains d’entre eux, leurs apports, dépassant parfois largement le cadre de leur spécialité, découlent directement de leur présence en terres maghrébines comme pour la méthode d’algèbre linéaire de Cholesky.
Un autre point important est la question des collaborations éventuelles avec des acteurs autochtones (on disait à l’époque « indigènes »). C’est un champ d’étude difficile à explorer tant, au XIXe siècle, les sources provenant des acteurs eux-mêmes sont rares et peu documentées mais pour certains – comme Hafnaoui Mohamed ad-Dissi (1852 – 1942) – les collaborations sont clairement établies. [29]
- Un célèbre collaborateur des orientalistes français : Al-Hafnaoui ad-Dissi (1852 – 1942)
Si nous revenons à Brocard, l’un des acteurs centraux de cet article et sur lequel nous disposons de nombreuses informations, force est de reconnaître qu’il est très imprécis sur ceux avec lesquels il a mené ses recherches scientifiques. Dans sa Notice sur les titres et travaux scientifiques pourtant méticuleusement détaillée, nous n’y trouvons pratiquement pas d’indications sur ces collaborations avec des indigènes. [30]
Notons toutefois qu’il indique à propos d’un Essai de vulgarisation scientifique, notion d’astronomie populaire publié sous la forme d’une série d’articles entre le 12 décembre 1874 et le 23 octobre 1875 : « ces articles, rédigés à l’intention des indigènes, ont été réservés aux numéros du samedi, seuls traduits en arabe, du Journal officiel de l’Algérie, le Mobacher […] La traduction a été confiée aux soins de M. Arnaud, interprète militaire [31], et de deux interprètes indigènes ». [32]
De même, pour l’Exposition générale de la Société d’agriculture d’Alger de 1876, des affiches explicatives concernant un nouvel appât-sauterelles ont été réalisées. Brocard indique que « quelques-unes, traduites en arabes, [étaient] destinées à initier le public au but poursuivi » [33] mais malgré les nombreux détails qu’il donne sur les bulletins météorologiques quotidiens et sur le fonctionnement du service météorologique, aucune mention n’est faite sur le statut et la qualité des « observateurs », comme les nomme Brocard. La place des traducteurs et des observateurs des milliers d’expériences scientifiques qui ont eu lieu en Algérie au XIXe siècle reste un vaste champ d’études à défricher.
Cheikh Lmuhub explique en 1852 comment il a constitué ouvrage après ouvrage sa bibliothèque : « Mes ouvrages […] rédigés, copiés ou achetés […] doivent servir à ceux qui possèdent des connaissances et à ceux qui recherchent le savoir ». [34]
L’un des devoirs de l’historien consiste à reconstituer les bibliothèques d’hier pour mieux comprendre – sans position partisane – le passé. La compréhension des sciences et des multiples voies de circulations orales et matérielles au Maghreb au XIXe siècle n’en est qu’à ses balbutiements. En France, nous possédons de nombreuses archives relatives aux centaines d’acteurs scientifiques qui ont occupé des fonctions dans les colonies maghrébines au XIXe et XXe siècle. Beaucoup n’ont été que fort peu exploitées. En Algérie, en Tunisie ou au Maroc des dizaines de bibliothèques contiennent des milliers de manuscrits … qu’il reste à étudier. « À ceux qui recherchent le savoir » le chemin est pavé de traces du passé à explorer patiemment et collectivement.
Pascal Crozet a montré comment en Égypte, il y a eu une appropriation de savoirs européens par des élèves égyptiens devenus maîtres tout au long du XIXe siècle. [35]
Plus récemment, Dominique Tournès a montré que le « corps de doctrine » mis en place par Maurice d’Ocagne (1862-1938) (la nomographie) a été véhiculée et appropriée en Égypte par l’un de ses élèves Farid Boulad Bey (1872-1947), formé initialement à Paris à l’École des ponts et à l’École centrale des arts et manufactures, et par d’autres acteurs en poste au Caire. [36]. Encore, plus récemment Alain Messaoudi s’est intéressé, après une enquête archivistique minutieuse, aux savants orientalistes, interprètes militaires et civils, professeurs, employés de l’État, etc qui se sont impliqués dans le processus colonial au Maghreb et au Levant. [37]
Pour l’Algérie, tout un champ de recherches dans lequel veut s’insérer notre contribution est à poursuivre pour comprendre dans leur complexité les processus de circulations ou de non-circulations (des hommes, des livres et des idées) et pour, selon l’expression de Dipesh Chakrabarty, « provincialiser l’Europe » non pas pour rejeter la pensée et les apports européens mais pour décentrer méthodologiquement le regard afin d’appréhender différemment les sociétés étudiées et, en l’occurrence, les mathématiques, les sciences et les savoirs, qui s’y sont développées. [38]
Cet article est une reprise adaptée à Images des mathématiques de : Romera-Lebret, Pauline & Verdier, Norbert, « Faire des sciences en Algérie au XIXe siècle : individus, lieux et sociabilité savante », Philosophia Scientiae, 20 (2), (2016), 5-31. Il s’agit du premier pan d’un travail historique regroupant différents chercheurs et pas seulement historiens des sciences afin d’apporter des éclairages historiques, scientifiques, institutionnels, sociétaux et prosopographiques sur le Maghreb scientifique du 19e siècle. Ce projet collectif permettra de cerner avec davantage d’acuité les réseaux de circulation des savoirs entre le Maghreb et la France, deux entités ayant tissé entre elles des relations riches, complexes et désormais anciennes. C’est dans cet esprit que nous avions organisé une séance du séminaire d’histoire des mathématiques, le 29 novembre 2013 ; elle s’intitulait : « Sciences et techniques au Maghreb au XIXeme siècle : regards croisés ».
Enfin, la rédaction d’Images des Mathématiques s’associe à nous pour remercier
les relecteurs Frédéric Piou, Bernard Valentin, Aityoussef Abdelkarim et Julien Melleray
de leurs remarques constructives.
Article édité par Norbert Verdier
NOTES
[1] Pour obtenir des informations générales et synthétiques sur le Maghreb tout au long du dix-neuvième siècle, nous renvoyons à l’ouvrage : Rivet, Daniel, Le Maghreb à l’épreuve de la colonisation, Pluriel, 2010.
[2] Nous ne détaillerons pas ici davantage ces problèmes de combinatoire mais renvoyons à la conférence d’Évelyne Barbin : « Gaston Tarry et la combinatoire : le problème des dominos et le problème des trente-six officiers » in « Les travaux combinatoires de l’entre-deux guerres 1870-1914 : leur actualité pour les mathématiques d’aujourd’hui », 30 septembre-02 octobre 2015, lycée Pierre Bourdan, Guéret. Un ouvrage est en préparation.
[3] Pour davantage d’informations sur la surface sociale et scientifique d’Arago, nous renvoyons à : Lequeux, James, François Arago, un savant généreux. Physique et astronomie au XIXe siècle, collection « Science et histoire », Paris, EDP Sciences, 2008.
[4] Pour avoir des informations sur la genèse de cette commission scientifique, fondée en 1839, nous renvoyons à : Bettahar, Yamina, « La géologie en Algérie (1880-1940) », La revue pour l’histoire du CNRS, 18 ( 2007), mis en ligne le 03 octobre 2009, consulté le 29 mars 2016.
[5] Pour une histoire de l’agrégation, nous renvoyons à : Chervel, André, Histoire de l’agrégation, Paris, INRP-Éditions Kimé, 1993.
[6] Au moment où Aimé est nommé, cet établissement vient d’être fondé et commence à prendre son essor. Il compte une centaine d’élèves – fils de fonctionnaires, de militaires ou de colons de la première heure – et quelques professeurs.
[7] Carpine-Lancre, Jacqueline, « Georges Aimé (1810, Metz-1846, Alger) », Chronique d’histoire maritime, 55 (2004), 60-76. Indiquons que le Musée océanographique de Monaco possède un buste de Georges Aimé ; nous n’avons pas été autorisé à en diffuser une représentation.
[8] Aïssani, Djamil « Le mathématicien Eugène Dewulf (1831–1896) et les manuscrits médiévaux du Maghreb », Historia Mathematica, 23 (1996), 257 – 268.
et
Rouxel, Bernard & Aïssani, Djamil, « Le géomètre Albert Ribaucour à Bougie », Actes du Colloque International « Béjaïa et sa région à travers les siècles : Histoire, Société, Sciences, Culture », Béjaïa, novembre 1997, pp. 63 et suivantes & Rouxel, Bernard, « L’œuvre mathématique d’Albert Ribaucour », Archive for History of Exact Sciences, 23 (1980), 159-177. L’article de Rouxel et Aïssani contient un portrait inédit de Ribaucour.
[9] Kummer, Ernst, Eduard, « Théorie générale des systèmes de rayons rectilignes », Nouvelles annales de mathématiques, II, 1 (1862), 31-41, 82-102.
[10] Voir Dewulf, Eugène, « Théorème sur les normales » , Nouvelles annales de mathématiques, 1 (16) (1857), 464.
[11] Millán Gasca, Ana (Sous la direction de), « La corrispondenza di Luigi Cremona (1830-1903) », volume 1, Quaderno, Serie di Quaderni della Rivista di Storia della Scienza, 24 (1992), 11-76.
[12] Pour avoir davantage d’informations sur les travaux géométriques de Dewulf, nous renvoyons à : Aïssani, Djamil « Le mathématicien Eugène Dewulf (1831–1896) et les manuscrits médiévaux du Maghreb », op. cit.
[13] On pourra consulter : http://images.math.cnrs.fr/Apprendre-les-mathematiques-au.html
[14] Pour une histoire de la Société mathématique de France, nous renvoyons à : Gispert, Hélène, La France mathématique de la IIIe République avant la Grande Guerre, série T, Paris : Société mathématique de France, 2016.
[15] Sa correspondance est conservée à la Bibliothèque de l’École Polytechnique, à la Bibliothèque de l’Institut et à la Bibliothèque de l’Université de Liège
[16] Rouxel, Bernard & Aïssani, Djamil, « Le géomètre Albert Ribaucour à Bougie », op. cit.
[17] Romera-Lebret, Pauline, La nouvelle géométrie du triangle, passage d’une mathématique d’amateurs à une mathématique d’enseignants (1873-1929), Thèse de doctorat sous la direction d’É. Barbin, Épistémologie, Histoire des sciences et des techniques, Université de Nantes, 2009 et Romera-Lebret, Pauline, « La nouvelle géométrie du triangle à la fin du XIXe siècle : des revues mathématiques intermédiaires aux ouvrages d’enseignement », Revue d’Histoire des mathématiques, 20 (2014), 253-302.
[18] Nous avons très peu d’informations biographiques. Il serait né le 27 décembre 1889 à Vieux habitants en Guadeloupe. Nous remercions Bernard Bru qui a obtenu cette information grâce au site généalogique : Geneanet
[19] Sainte-Claire Deville, Charles, « Le réseau météorologique algérien », Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences, LXXIX (1874), 195-196.
[20] Brocard, Henri, Notice sur les titres et travaux scientifiques, Bar-le-Duc, 1895.
[21] Voir Auvinet, Jérôme, Charles-Ange Laisant : Itinéraires et engagements d’un mathématicien de la Troisième République, Paris, Hermann, 2013.
[22] Sciavon, Martina, « Geodesy and Map-Making in France and Algeria : Contests and collaborations between Army officers and Observatory Scientist » in The Heavens on Earth. Observatories and Astronomy in the Nienteenth Century, sous la direction de D. Aubin, C. Bigg & H.O. Sibum, Duke University Press, 148-173.
[23] Pour une étude de la cartographie au XIXe siècle, nous conseillons : Verdier, Nicolas, La carte avant les cartographes, l’avènement du régime cartographique en France au XVIIIe siècle, Paris : Presses de la Sorbonne, 2015 et pour une histoire de la cartographie en Algérie, nous renvoyons à : Blais, Hélène, Mirage de la carte. L’invention de l’Algérie coloniale, Paris : Fayard, 2014.
[24] Mignard, Gérard, « Charles-Louis Du Pin (1814-1868), « un intellectuel baroudeur né à Lasgraïsses », Revue du Tarn, 168 (Hiver 1997), 535-561.
[25] Brezinski, Claude & Gross-Cholesky, Michel, « La vie et les travaux d’André Louis Cholesky », Bulletin de la Société des Amis de la Bibliothèque de l’École Polytechnique, 39 (décembre 2005) & Claude Brezinski et Dominique Tournès, André-Louis Cholesky, Mathematician, Topographer and Army Officer, Basel : Birkhäuser, 2014.
[26] Mansuy, Roger, « André Louis Cholesky, « Sur la résolution numérique des systèmes d’équations linéaires », in Regards sur les textes fondateurs de la science, vol. 1, sous la direction d’Alexandre Moatti, Le sel et le fer, Cassini, 129-136 & 229-239.
[27] Cette bibliothèque de trois cents livres classifiés en une vingtaine de section était connue des orientalistes du XIXe siècle. Incendiée en 1957 par le pouvoir colonial, elle a été partiellement reconstituée il y a une vingtaine d’années grâce à l’association GEHIMAB et à des descendants de Cheikh Lmuhub. Voir L’Âge d’or des Sciences en Pays d’Islam. Les manuscrits Scientifiques du Maghreb, op. cit., 19-20.
[28] Aïssani, Djamil & Mechehed, Djamel, Eddine, Manuscrits de Kabylie : Catalogue de Collection Ulahbib, Association Gehimab Ed., 1996 ; deuxième édition : CNRPAH. Ed., Alger, 2011.
[29] Hafnaoui Mohamed ad-Dissi est l’auteur de l’ouvrage bio-bibliographique des Uléma (savants) algériens du Maghreb central (du XIIe au XIXe siècles) (al-Hafnaoui Mohamed, « Ta`rif al-Khalaf bi Ridjal as-Salaf », 1905 – 1907. Réédité par la
SNED Alger, 1970.). Diplômé des célèbres Zawiyya – Institut Ouboudaoud (Taslent) et Zawiyya – Institut de Chellata, il débarque à Alger vers 1886. C’est en 1907 qu’al-Hafnaoui est entré en contact avec les Français. Il apprend la langue auprès de Monsieur Arnaud, directeur du journal al-Moubacher. Al-Hafnaoui précise qu’il avait été son secrétaire durant 12 ans. Arnaud l’a beaucoup aidé pour approfondir ses connaissances. Al-Hafnaoui fera par la suite plusieurs voyages en France. C’est ce qui va lui permettre de rédiger des articles de vulgarisation et faire plusieurs traductions (ouvrage d’apiculture, de chimie et d’astronomie, la rage chez les médecins arabes,…). En particulier, il va traduire un livre sur la santé avec le concours de Jean Mirate. De manière générale, ses articles s’articulent autour des sciences humaines, de l’astronomie, de l’économie, de l’éducation, et des sciences de la nature.
[30] Brocard, Henri, Notice sur les titres … op.cit.
[31] Cf. note précédente sur Hafnaoui Mohamed ad-Dissi
[32] Ibid., I, 24.
[33] Ibid., III, 30.
[34] Djamil Aïssani et Djamel Mechehed, « Usages de l’écriture et production des savoirs dans la Kabylie du XIXe siècle », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 121-122 (avril 2008), mis en ligne le 05 janvier 2012, consulté le 30 novembre 2015.
[35] Crozet, Pascal, Les sciences modernes en Égypte. Transfert et appropriation (1805-1902), Paris : Geuthner, 2008.
[36] Tournès, Dominique, « Querelles de priorité autour de la nomographie » in séance du séminaire d’histoire des mathématiques de l’IHP sur Maurice d’Ocagne (1862-1938), 20 mars 2015.
[37] Messaoudi, Alain, Les arabisants et la France coloniale. Savants, conseillers, médiateurs (1780-1930), Lyon, ENS Éditions, coll. « Sociétés, espaces, temps », 2015.
[38] Chakrabarty, Dipesh, Provincialiser l’Europe. La pensée postcoloniale et la différence historique, Paris : Éditions






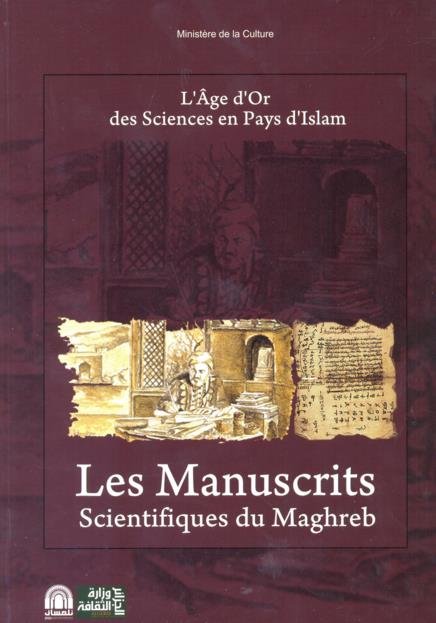





















1 comment
tres tres tres interessant, merci Hope.